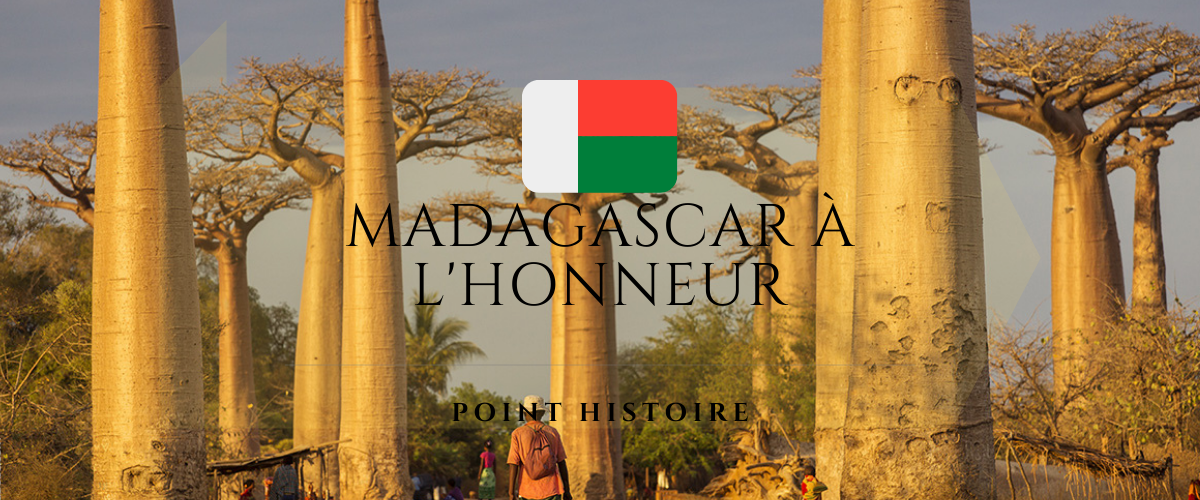Un parcours politique exceptionnel
Si dans un premier temps elle a grandi entre la
Tunisie, la France et l’actuel Mali, après la mort de son père, sous-officier
de l’armée française, Gisèle Rabesahala retourne en 1942 à Madagascar.
Consciente très tôt de l’importance de l’instruction et de l’éducation malgré
la place marginale qu’occupe la femme dans la société malgache, elle obtient
son brevet d’études élémentaires, poursuivant avec une formation
professionnelle de sténodactylographe (« l’art d’écrire aussi vite que la
parole »).
Soucieuse des enjeux structurels qui traversent la
société malgache, Gisèle Rabesahala s’est précocement propulsée dans un
parcours politique. Toujours aux avant-postes, cette jeune fille va devenir à
l’âge de 17 ans la secrétaire au sein du Mouvement démocratique pour la
rénovation malgache (MDRM) et à la tête de l’AFKM, parti de l’indépendance crée
en 1958. Dans le contexte d’agitation politique de 1947 où des parlementaires
sont arrêtés et traduits devant la justice, elle devient secrétaire des avocats
de la défense. « Je rêvais d’être avocate, parce que je pensais qu’un
avocat doit se consacrer à la défense des innocents », écrit-elle
alors dans son autobiographie, Que vienne la Liberté, publiée
en 2006, dans laquelle elle expose ses opinions et revient plus généralement
sur l’histoire politique malgache. En 1950, elle fonde également le Comité de
Solidarité de Madagascar dont l’objectif est de venir en aide aux détenus
politiques et leurs familles, en particulier à leurs femmes, sœurs et filles.
Impliquée dans la gestion des crises politiques
malgaches, la singularité de Gisèle Rabesahala tient ainsi à la position
dominante qu’elle a su occuper dans un monde politique, alors majoritairement
dominé par les hommes. Après l’accession du pays à son indépendance, elle va
s’imposer dans la classe politique du nouvel État malgache. En 1977, elle est
nommée ministre des Arts et de la Culture révolutionnaire. Convaincue que
l’avenir d’un pays doit être fondé sur son patrimoine culturel et historique,
elle place la revalorisation de la culture malgache au centre de ses combats
Cette politique passe par la création de structures diverses mettant en valeur
les richesses culturelles du pays, œuvrant pour la promotion de la langue et de
l’identité malgache. L’inauguration de la bibliothèque nationale en 1982 est un
exemple phare de celle-ci.